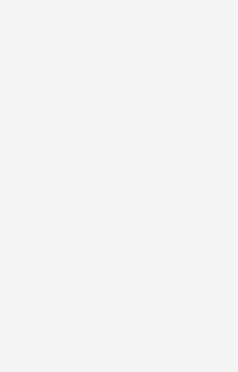Cette chronique s’attache à discuter de la difficulté de gérer les figures d’autorité officieuses et le positionnement politique de la chercheuse lors d’un terrain de sociolinguistique en milieu rural sud-africain.

Le village
À l’automne dernier, je me trouve dans un village de la région du Cap-Oriental en Afrique du Sud dans lequel j’ai été invitée par Siya, une « enfant du coin », pour venir y mener une partie de mes recherches. Situé en territoire ancestral xhosa, le village est idéalement positionné sur l’océan indien et forme une étendue de huttes parsemées sur les collines alentour. Le village vit au rythme de la ruralité, à quelques heures de route de la ville la plus proche, les femmes et les jeunes enfants occupent le paysage car la plupart des hommes travaillent dans les mines, dans une autre région du pays.
Il y a deux décennies déjà, le village a accueilli une première ONG sud-africaine, dont la mission de développement s’est focalisée sur l’assainissement de l’eau, la création d’écoles et d’infrastructures médicales, mais aussi la création d’un écolodge pour les randonneurs de passage. Depuis, deux autres ONG se sont implantées, une internationale et une sud-africaine. Au village règne une atmosphère dite kumbaya, c’est-à-dire une idéologie de la positivité et du non-conflit, chère à certaines communautés blanches en Afrique du Sud, qui tend à effacer les rapports de pouvoir et les oppressions qui ont lieu là où des projets dérivés de l’idéologie du sauveur blanc sont implantés. Au village s’observe donc une fausse tranquillité des rapports entre villageois et ONG, car la règle est de ne pas discuter (ou de ne pas dénoncer, sur les réseaux sociaux par exemple) des problèmes qui pourraient exacerber les rapports sociaux de race et endommager le discours idéal(isé) de l’Afrique du Sud réconciliée.
Ayant été invitée dans ce village par Siya, une personne se considérant comme ambassadrice de la culture xhosa, je n’ai d’abord pas compris pourquoi elle ne m’avait pas prévenue d’une telle situation. Elle m'expliquera plus tard qu’elle n’avait pas vraiment pensé à m’en parler car elle essayait de se situer en dehors de cette dynamique, par mécanisme de défense ou de protection peut-être ? Elle voulait également que je me fasse ma propre idée.
La demande
Dans la tradition politique xhosa, un village est supervisé par un représentant local désigné par le chef de plusieurs villages voisins, et ainsi de suite de manière pyramidale jusqu’au chef le plus haut placé. Afin de mener mes recherches dans le village, il était alors nécessaire d’obtenir l’autorisation du chef. Dans mon cas, après deux semaines sur place et l’arrivée de Siya, la personne qui m’avait invitée et devait jouer le rôle d’assistante-interprète pour mes recherches, nous avons entrepris de demander l’autorisation à No, la cheffe des quatre villages alentour. En l’appelant pour lui demander quand nous pouvions la rencontrer et obtenir sa permission, elle nous donne immédiatement son feu vert par téléphone en mentionnant que nous pouvons commencer par un entretien avec elle. Je suis ravie car en plus d’obtenir l’autorisation de l’autorité traditionnelle, je peux commencer mes recherches en m’entretenant avec une des rares femmes à représenter une figure politique locale, un plus pour mon sujet qui s’intéresse aux pratiques langagières de respect dans la culture xhosa.
C’est à la suite de cet appel téléphonique que l’un des plus grands dilemmes de ce terrain s’est présenté à moi : Siya me demande si j’ai obtenu la permission de mener mes recherches auprès du responsable de la principale ONG du village. Pour être honnête, je suis abasourdie par cette question. Pour insister sur la situation dans laquelle je me trouve, cette question m’est posée par mon amie xhosa, qui se trouve avec moi dans le village où elle habite et où elle m’a invitée, village situé en territoire ancestral xhosa, après avoir obtenu l’accord de la cheffe xhosa. Tout semble indiquer qu’un individu dont la couleur de peau est aussi claire que la mienne est un étranger ici. En réalité, me demander si un Sud-africain blanc, responsable d’une des ONG implantées au village, m’a donné le feu vert pour mener mes recherches sur des pratiques sociolangagières en xhosa me propulse dans un réel inconfort éthique.
Le refus
À ce moment de mon terrain, j’ai d’abord une réaction nette de refus. Quand Siya me pose cette question, je lui partage mon étonnement, puis je lui indique que je refuse de demander la permission à cette personne. De plus, j’avais obtenu la permission de l’autorité traditionnelle, il n’y avait donc, selon moi, aucune légitimité à demander une autorisation à une personne étrangère à la culture xhosa. Sans naïveté, je connaissais l’importance sociopolitique de cette personne et de son ONG dans le village, mais comment pouvais-je accéder à une telle requête ?
Le faire, c’était accepter la dynamique néocoloniale au village, passer outre les inégalités observées et la tension qui m’avait déjà été partagée par plusieurs personnes. Le faire c’était me positionner comme alliée des ONG, c’était renforcer le caractère oppressant de ces projets de développement et alimenter la dynamique raciale au village. Au cours de mon séjour, je serai d’ailleurs la témoin de multitudes de comportements et discours racistes, certains subtiles et d’autres beaucoup moins, qui me forceraient à me situer en opposition de mes « pairs » — c’est-à-dire des étrangers au village, et plus particulièrement des personnes blanches — pour espérer construire des relations viables avec la communauté. Le faire, c’était pour moi comme une trahison qui me mènerait à collaborer avec le racisme.
Ne pas le faire, c’était avant tout, pour moi, dans le contexte du terrain, refuser de participer à la politique du sauveur, reconnaître l’agentivité des personnes rencontrées au village, respecter la communauté xhosa dans laquelle j'avais été invitée. Au moment du terrain, ne pas le faire me semblait être une évidence, au-delà de mes réflexions sur l’éthique de ma recherche, bien que cette évidence soit également le fruit de ma propre lecture de la situation.
Le faire, ne pas le faire, telle était la question. J’avais été mise dans cette position et je devais faire un choix, même s’il ne pouvait pas me satisfaire. Parce que je ne pouvais pas refuser complètement et nier les enjeux de pouvoir locaux, les possibles conséquences sur les personnes qui choisiraient de participer à mes recherches ou les difficultés auxquelles mon assistante de recherche pourrait faire face puisqu’elle m’avait invitée dans ce village, il fallut trouver une solution.
L'alternative
Face à mon refus immédiat, dont j’ai fait part à Siya car nous nous entendions comme des amies et avions déjà discuté de cette situation au village, elle me dit ouvertement que si je ne jouais pas le jeu, il y aurait effectivement des conséquences pour elle. Elle me dit notamment qu’elle serait critiquée pour s’être permise d’inviter une chercheuse au village. J’appris alors que Mike avait l’habitude de faire venir des chercheurs au village, par le biais de son ONG, et que j’étais donc la première chercheuse à mettre les pieds ici sans que mon projet n’ait été approuvé par le chef officieux du coin. J’appris aussi au cours de mon séjour que les locaux étaient constamment inquiets de savoir qui était un espion pour le compte de Mike, car ils n’étaient pas libres de discuter sans que leurs paroles ne soient rapportées ensuite. Une réelle tension régnait donc dans les coulisses des interactions au village.
Parce qu’au moment du terrain, dans une situation qui m’était inconfortable, j’ai refusé de demander cette seconde permission, cette demande explicite s’est transformée, à l’initiative de Siya, en une demande implicite, sous la forme d’un partage d’information. Siya envoya donc une note vocale à Mike, en lui indiquant pour quelles raisons elle m’avait invitée au village — j’avais déjà rencontré Mike et discuté de mes recherches, sans savoir qu’il était le chef officieux du village — et en lui indiquant que nous allions nous promener de propriétés en propriétés pour des entretiens. Nous reçûmes une réponse rapide qui indiquait qu'il m’avait effectivement rencontrée et que nous avions discuté de mon projet, et que nous étions « libres » de circuler dans le village.
En proposant une alternative à la demande officielle de permission, mes recherches ont été propulsées dans la sphère politique locale. Les rapports de pouvoir entre l’autorité traditionnelle locale, la position de chef officieux du village que représentait Mike, les personnes du village et ma position de chercheuse se jouaient ici dans cette « simple » demande de permission.
Accéder à cette demande d’autorisation me semblait impossible au moment où elle m’a été adressée sur le terrain. De manière détournée, nous avons tout de même demandé cette permission et cette décision s’est révélée importante pour la communauté locale car elle ne niait pas les rapports de pouvoir implicites. Il est aussi important de considérer que ce choix a pu avoir des répercussions sur mes recherches. Cette prise de position m’a à la fois fermé un réseau, celui des partisans et alliés des ONG, mais elle m’a surtout donné accès à un réseau parallèle où contestations et contre-récits m’ont été partagés, ouvrant ainsi un espace de discussion qui n’avait pas été anticipé.
Politique, engagement et méthodologie
Pour conclure sur une note méthodologique, si je me suis retrouvée dans une situation d’inconfort évidente (cf. chronique « Quand non, c’est non […] »), c’est aussi et surtout mon engagement affectif sur mon terrain, ou plutôt mon insertion sentimentale sur mon terrain (cf. Olivier de Sardan, 2008), qui ont été mis en difficulté par la situation néocoloniale dans laquelle le village se trouvait et qui ont influencé mes choix méthodologiques, qui sont devenus des choix politiques dans le contexte de ce terrain.
* Les prénoms ont été modifiés.
« Est-ce que tu as demandé la permission à Mike* ? »La réponse est non. La suite est plus complexe.