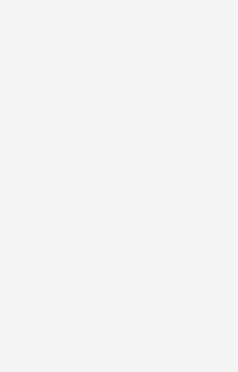À partir du récit d’une rencontre avec une personne porteuse du syndrome d’Asperger, cette chronique questionne les difficultés, volontairement gardées sous silence, qui jalonnent inévitablement les rencontres et les enquêtes de terrain.

La rencontre avec Lierre Rose
Je devais me rendre chez Lierre Rose 1Je reprends ici les pseudonymes utilisés dans ma thèse (voir mon projet de recherche), porteuse du syndrome d’Asperger, à environ deux heures de route de chez moi. Ce jour-là a été marqué par une pluie battante et ininterrompue. Je suis donc partie, guidée par un GPS manifestement déboussolé : celui-ci m’a amenée à me perdre dans des embranchements multiples du périphérique de Liège en heure de pointe. Après près d’une heure d’égarement sur ces routes mouvementées, je m’arrêtai pour appeler Lierre Rose et lui annoncer, contrite, mon incapacité à me rendre chez elle. Ce qu’elle comprit parfaitement. Elle me proposa de venir par elle-même à Liège. Quelques jours plus tard, nous pouvions enfin nous rencontrer dans un café. Il s’était avéré que ma maladresse, ma faiblesse momentanée et pleinement reconnue, mon incompétence au volant, l’avaient rassurée, et même lui avaient permis de m’accorder sa confiance ; comme elle me l’exprima : « Je me suis dit : celle-là, elle est aussi bizarre que moi ! ». Entre « bizarres », on peut se comprendre... « Bizarrerie » que j’ai pourtant souhaité taire dans ma thèse : cela touchait-il à un trait de caractère trop personnel ? C’est ce que j’ai ressenti : j’ai préféré dissimuler ce qui parlait trop d’un aspect de ma personne, dont je pensais qu’« on » (mais qui ?) aurait pu le rattacher à une « tare » (pour reprendre l’expression utilisée par Lierre Rose pour qualifier son autisme), à une incompétence (bien qu’en l’occurrence bénéfique), ou à ce que je concevais comme une preuve d’amateurisme. En résumé : pas de quoi être fière... Pourtant, cette difficulté tue s’est avérée avantageuse.
Les particularités dans le traitement des informations perceptives et sensorielles sont aujourd’hui considérées comme centrales dans l’autisme et j’ai voulu étudier comment le mode hypersensoriel d’être au monde, qui est celui de bon nombre de personnes autistes, pouvait modeler leurs représentations des éléments vivants non-humains, animaux et végétaux, et leur manière de s’y connecter. Je suis donc allée à la rencontre de personnes porteuses du syndrome d’Asperger pour recueillir leurs témoignages et vivre auprès d’elles dans leurs environnements quotidiens, tantôt dans une maison isolée au milieu des bois en Sologne, tantôt dans une communauté anarchiste dans un village cévenole.
L’apparence souvent lisse et sans accroc notoire que prennent bon nombre de recherches, à la rigueur les quelques difficultés bien circonscrites, parfois évoquées lorsque cela sert le propos, peuvent parfois cacher un envers du décor pudiquement dissimulé : les tâtonnements, les ratés, les maladresses, les impossibilités, les revirements de dernière minute, les abandons, tracent tout un paysage accidenté qui est, me semble-t-il, un des aspects incontournables de la recherche qualitative. Pourquoi taire des difficultés de cette nature, qui pourraient cependant apporter quelque chose à la réflexion ? Crainte de voir notre compétence remise en question ? Difficulté d’être honnête avec soi-même ? Ce n’est pourtant pas un secret : les études de terrain, les rencontres en direct, sont des expériences dont il est fort à parier qu’elles nous placent hors de notre « zone de confort » et nous confrontent à nos limites. Que partager ensuite de nos rencontres, de nos expériences de terrains ? Que peut-on laisser ou non filtrer dans les textes ethnographiques rendus publics ? Où pouvons-nous bien remiser les embûches matérielles, la lassitude, les inconforts physiques, les craintes et les risques ?
Voici à présent quatre explications à ces différents types de silences.
Quatre types de silences
La première explication est d’ordre épistémologique et concerne mon arrière-plan disciplinaire. Ayant fait des études de psychologie clinique, j’ai négligé d’interroger un aspect présenté comme fondamental pour mener des recherches dans cette discipline : celui de la neutralité et de l’extériorité vis-à-vis de notre objet d’étude. Autrement dit, de près ou de loin, le chercheur ne doit pas être concerné personnellement par ce qu’il étudie, afin de ne pas risquer de porter atteinte à l’objectivité scientifique. Ainsi, je n’avais pas remis en question cette injonction disciplinaire et avais considéré comme relevant d’un biais à dissimuler une certaine forme de « familiarité » avec le terrain, comme l’écrit Flora Bajard, « chercheuse fille d’enquêtés » (2013, p. 7), encourageant au contraire à envisager les potentiels avantages heuristiques associés à cette position. Je tentais alors de dissimuler ce que je considérais comme relevant d’un défaut de légitimité.
La seconde explication est liée à la première et rejoint le problème posé par Jean-Pierre Olivier de Sardan : « la question de l’implication et la question de l’explicitation » (2000, p. 427). Qu’est-ce qu’un chercheur doit-il dévoiler des liens entretenus avec les enquêtés ? En l’occurrence, ce que j’ai souhaité garder secret dans la restitution de ma recherche, considérant cet aspect de ma vie comme personnel et privé, j’ai accepté de le dévoiler, le plus honnêtement possible et avec toutes les nuances que cela impliquait, aux personnes rencontrées dans le cadre de ma recherche, lorsque cela m’était demandé (et la levée de ce silence a souvent représenté une aide précieuse dans la rencontre avec ces personnes, ce qui aurait justifié son dévoilement). Ainsi, ce qui aurait pu me délégitimer aux yeux de certains chercheurs contribuait à me légitimer aux yeux de certains enquêtés.
Une troisième source de silence serait de nature éthique. En effet, une participante à mon mémoire de recherche (portant déjà sur le syndrome d’Asperger) m’avait fait remarquer, après l’avoir lu, qu’elle s’était sentie transformée en objet scientifique, représentant la catégorie à laquelle ma recherche l’avait faite appartenir. Chercheuse apprentie bien que déjà sensible à cette tendance, souhaitant répondre aux exigences d’objectivité et de neutralité, j’avais fait disparaître les sujets derrière des tableaux cliniques. Or, j’ai absolument voulu éviter de reproduire ce qui pourrait s’avérer déshumanisant pour les enquêtés lorsqu’ils liraient mon travail, comme certains le souhaitaient. Sachant que ce travail serait lu par quelques enquêtés, j’ai par ailleurs tenu à ne pas souligner les aspects de leur mode de vie ou de leur personne qui aurait pu s’avérer stigmatisant, ou pathologisant pour eux. Au risque d’appauvrir mon travail, j’ai préféré taire ces détails, qui, dévoilés, auraient pu heurter certains enquêtés-lecteurs.
Enfin, une quatrième cause de silence serait associée à une crainte, celle de dévoiler ce qui pourrait être, à tort ou à raison, interprété comme de l’incompétence. En effet, ces difficultés parlent parfois trop de nous-mêmes ; je pense notamment à mon expérience de rencontre avec Lierre Rose. Un nous-mêmes pas en tant que chercheurs, mais en tant qu’individus faillibles, fondamentalement limités ; et lorsque l’on s’imagine que nos failles seront perçues comme s’apparentant à de l’incompétence, nous tentons de mettre ça « sous le tapis », même lorsque cette faille a favorisé la rencontre.
On pourrait penser que ces expériences tues n’apportent rien à la recherche, parce qu’elles sont surmontables ou qu’elles n’interfèrent pas suffisamment avec notre travail, ce qui nous amène à les banaliser, à les oublier ; mais aussi parce qu’elles apparaissent comme inévitables, comme des effets secondaires, des à-côtés dont on n’a même pas idée de questionner le sens et les ressorts sous-jacents, comme des faits bruts, destinés à le rester, et que l’on oublierait presque de voir, de regarder, justement parce qu’ils sont scientifiquement muets au regard de notre objet d’étude. Cependant, il existe des limites inhérentes aux chercheurs : leurs failles, leurs incapacités, qui peuvent bien sûr être dépassées, avec lesquelles il est possible de composer, mais pas toujours. Or, ces difficultés mériteraient d’être pleinement reconnues dans nos recherches dans la mesure où elles peuvent permettre une forme de détours méthodologique s’avérant bénéfique lors de certaines rencontres. Alors pourquoi taire ces menus arrangements en supposant par avance que ce vaste et diversifié monde de la recherche ne serait pas en mesure d’accepter la dimension faillible des chercheurs, a fortiori dans la recherche qualitative, dont nous avons vu comment elle peut demander aux chercheurs d’affronter les difficultés en direct et souvent sans préparation, les forçant sans cesse à inventer et à improviser ?